Le Cancéropôle Île-de-France a organisé, le 13 mars 2025 en présentiel à Paris, un séminaire élaboré par son groupe de travail « Cancers et tumeurs rares » pour mettre en perspectives les cancers et tumeurs rares liés à des prédispositions génétiques, avec ceux liés à des expositions. Cette journée est à destination des chercheurs et cliniciens de toutes disciplines, institutionnels, représentants de patients impliqués dans des recherches dans le domaine du cancer.
Introduction
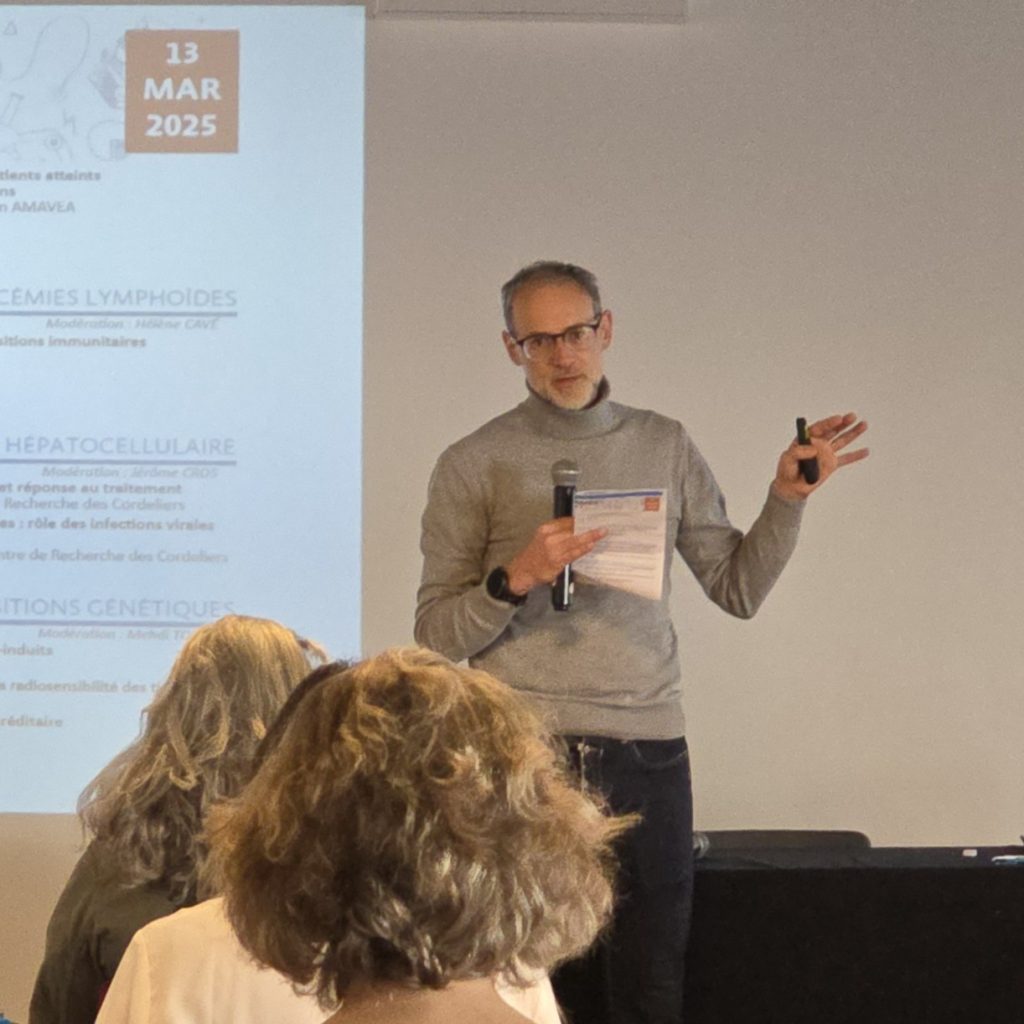
Jérôme Cros ouvre cette journée en remerciant l’ensemble des orateurs, des organisteurs et des participants pour leur implication dans cette journée de séminaire.
Ce groupe de travail fête ses 10 ans. D’abord coordonné par Anne-Paule Gimenez-Roqueplo puis par Jérôme Cros, ses membres s’impliquent dans un travail collaboratif duquel émerge différents projets de recherche en plus de l’organisation des journées de séminaire. Aujourd’hui le groupe souhaite montrer comment on peut aborder les effets des expositions et des prédispositions génétiques qui sont de plus en plus mélangés sur les cancers rares avec le peu de données existantes dans la littérature et les banques de données. Est-il possible de diminuer les expositions et d’améliorer le dépistage ?
Jérôme Cros, Coordinateur du groupe de travail
Exposome et risque de cancer : de la méthode, de la méthode
et encore de la méthode

Dans son intervention d’ouverture, Catherine Hill aborde le concept d’exposome, qui englobe l’ensemble des expositions environnementales non génétiques influençant le risque de cancer tout au long de la vie. Elle insiste sur l’importance des études épidémiologiques, même rétrospectives, pour évaluer ces risques, en soulignant que l’absence d’expérimentation ne doit pas invalider les données observationnelles. À travers divers exemples, elle illustre les conséquences du rejet des signaux d’alerte et critique également les réponses insuffisantes face à ces alertes. Elle montre que les études peuvent aboutir à des résultats contradictoires, souvent biaisés par des choix méthodologiques, rendant les conclusions peu fiables. Elle dénonce aussi la surinterprétation médiatique de certaines études et conclue en appelant à plus de rigueur scientifique.
Catherine HILL, Gustave Roussy – diaporama
Tumeurs du spectre BAP1
Mésothéliome sporadique versus mésothéliome BAP1 induit : quelles différences cliniques et thérapeutiques ?

Le mésothéliome est principalement causé par l’inhalation de fibres d’amiante, un matériau utilisé pour ses propriétés de résistance à la friction et d’isolation thermique. Cette maladie rare touche environ 900 à 1000 personnes par an en France, avec une incidence plus élevée dans les régions industrielles. Le délai de latence entre l’exposition à l’amiante et l’apparition de la maladie est de 30 à 40 ans, ce qui en fait une maladie des sujets âgés. Les fibres d’amiante provoquent une inflammation chronique, conduisant à la carcinogenèse. Il existe trois formes de mésothéliome. Les mutations de la protéine BAP1 sont fréquentes et jouent un rôle crucial dans la maladie, en effet les patients avec des mutations germinales de BAP1 ont souvent un âge de diagnostic plus jeune et une meilleure survie.
La présentation clinique du mésothéliome familial diffère de celle des formes sporadiques, avec une survie généralement meilleure.
Gérard ZALCMAN, AP-HP H. Bichat – diaporama
Biologie des méningiomes hormono-dépendants

Les méningiomes sont des tumeurs cérébrales qui touchent principalement les femmes, avec un lien établi entre ces tumeurs et les hormones féminines, notamment la progestérone. Les méningiomes présentent souvent des récepteurs à la progestérone, mais rarement des récepteurs aux œstrogènes. Les études montrent que les grossesses et les contraceptifs oestroprogestatifs classiques n’augmentent pas le risque de méningiome. Cependant, certains progestatifs de synthèse sont associés à une augmentation du risque. Les méningiomes hormonodépendants présentent un spectre mutationnel différent des méningiomes sporadiques, avec des mutations fréquentes des gènes PIK3CA et TRAF7. L’imprégnation hormonale semble influencer la localisation et le profil mutationnel des méningiomes, mais pas leur profil transcriptomique ou de méthylation. La susceptibilité génétique pourrait jouer un rôle dans le développement de ces tumeurs.
Matthieu PEYRE, AP-HP H. Pitié Salpêtrière, ICM, Renoclip – diaporama
Parangliomes
Environnement et paragangliome héréditaire SDHx-déterminé
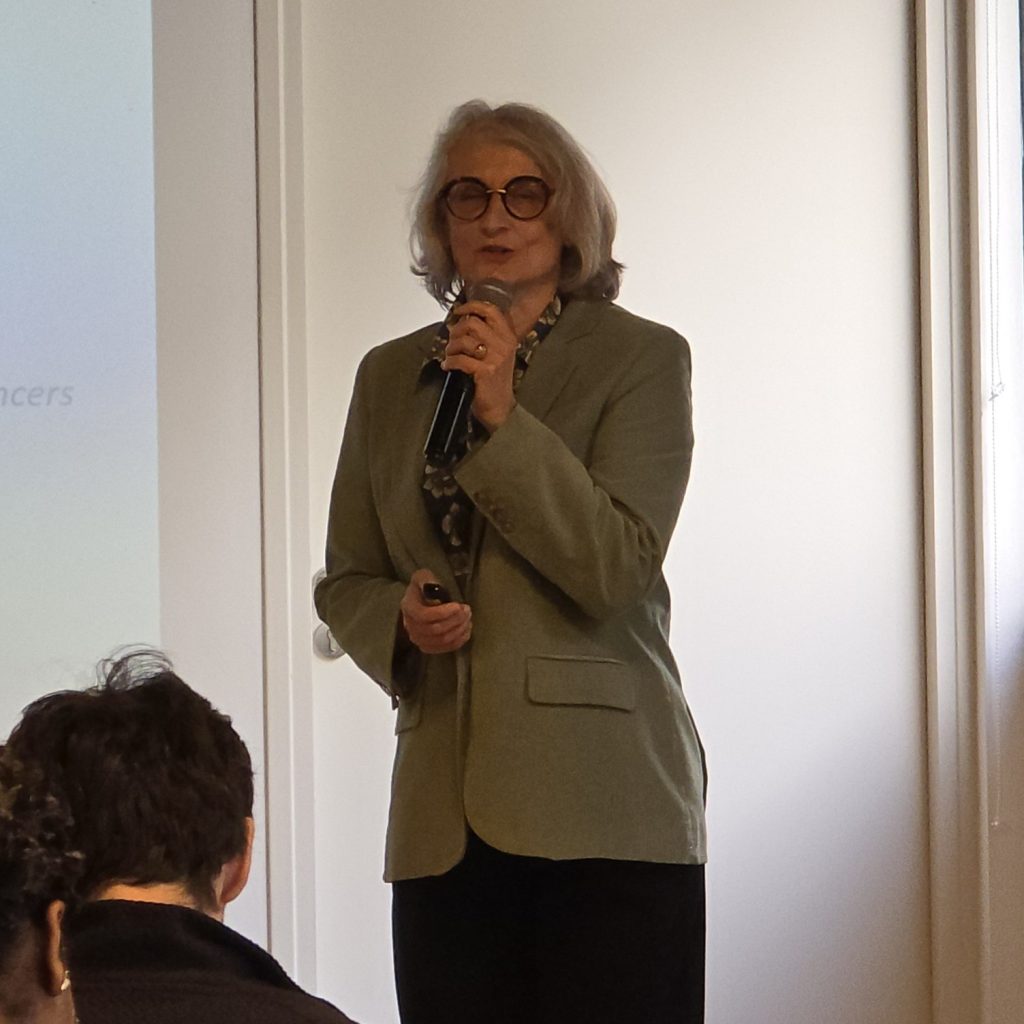
Les paragangliomes et phéochromocytomes sont des tumeurs neuroendocrines rares. Ces tumeurs sont difficiles à diagnostiquer et peuvent devenir malignes. Elles sont souvent liées à des mutations génétiques, notamment dans les gènes SDH, qui affectent le métabolisme mitochondrial. La recherche a montré que l’accumulation de succinate due à ces mutations entraîne des modifications épigénétiques et une activation des voies de l’hypoxie. Les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDHI), utilisés en agriculture, pourraient poser des risques pour les personnes génétiquement prédisposées. Une étude nationale est en cours pour évaluer l’impact des expositions environnementales sur le risque tumoral chez ces patients.
Anne-Paule GIMENEZ ROQUEPLO, Université Paris Cité, Inserm, AP-HP – diaporama
Pesticides et cancer : impact potentiel d’une exposition aux fongicides de la famille des inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDHi) sur la progression tumorale
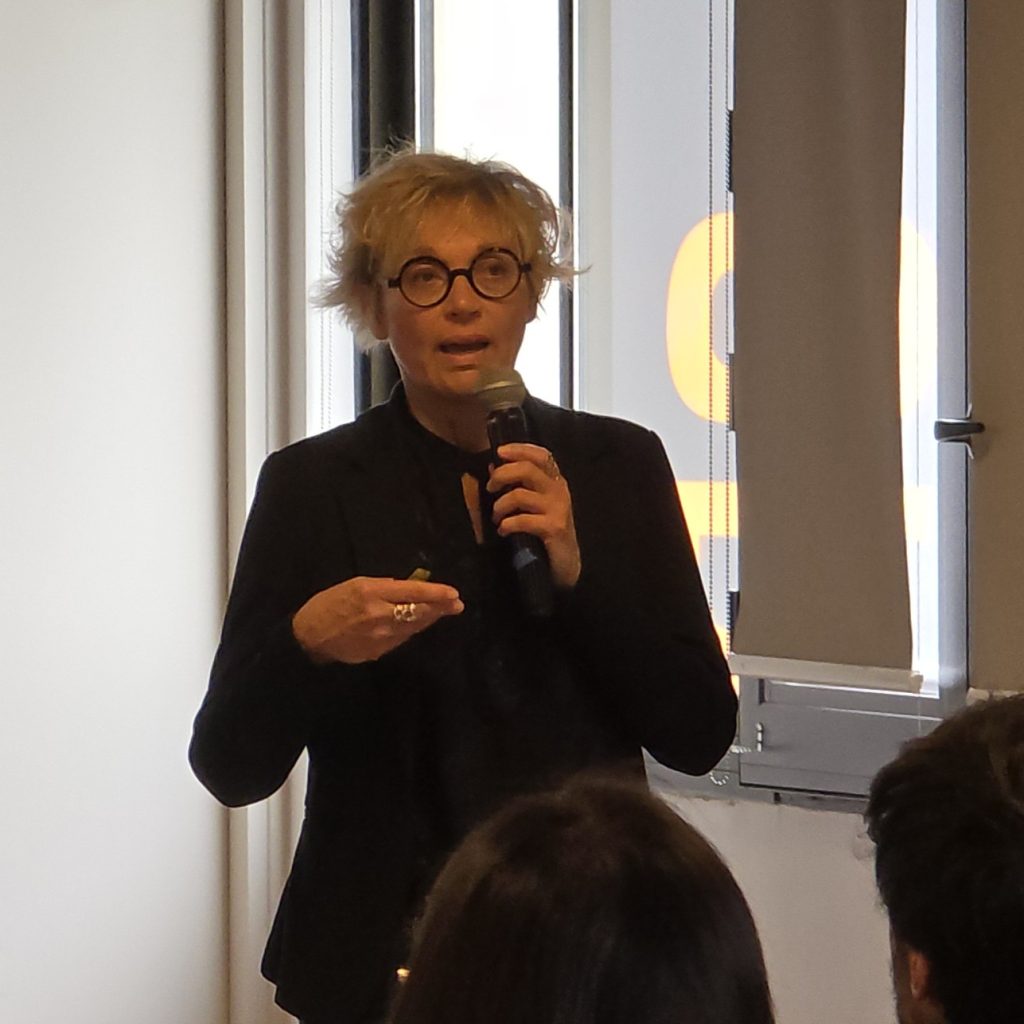
Les SDHI sont des fongicides utilisés pour protéger diverses cultures et espaces verts contre les champignons. Ils ciblent la succinate déshydrogénase (SDH), une enzyme cruciale pour la respiration cellulaire et le métabolisme. Bien que leur mécanisme d’action soit bien connu, les effets des SDHi sur la santé humaine sont peu étudiés. Des recherches montrent que les SDHi peuvent inhiber la SDH humaine, entraînant une accumulation de succinate, un oncométabolite. Ils induisent également des modifications métaboliques typiques des cellules cancéreuses et augmentent les capacités de migration et d’invasion des cellules. Ces effets sont similaires à ceux observés dans les tumeurs liées à des mutations génétiques de la SDH. L’exposition aux SDHi pourrait aggraver le phénotype tumoral chez les personnes déjà atteintes de cancers liés à la SDH et soulèvent des questions sur la sécurité de ces pesticides.
Sylvie Bortoli, Inserm, Université Paris Cité – diaporama
Le ressenti des patients
Ressenti et perception du risque par des patients porteurs
de prédispositions génétiques
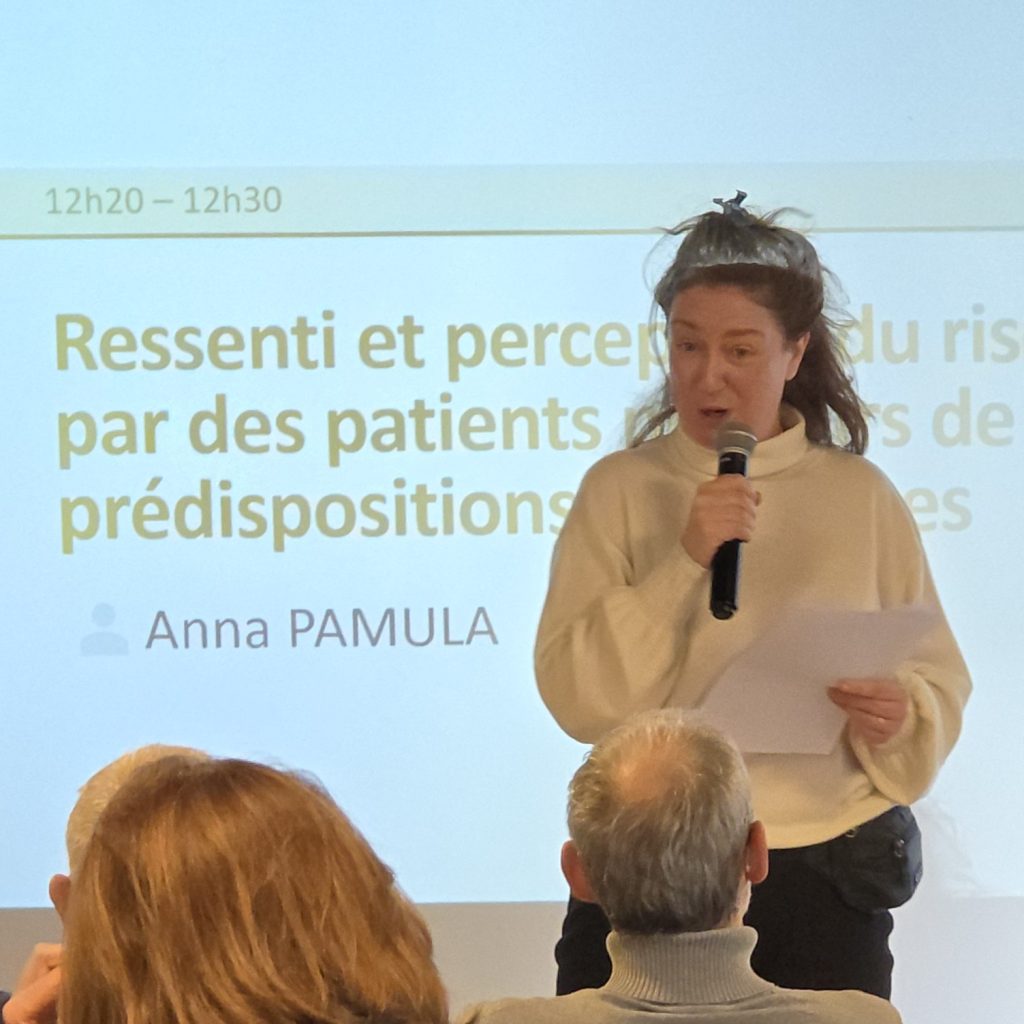
Ania Pamula, journaliste polonaise, partage son expérience avec la maladie de Von Hippel-Lindau (VHL), une condition génétique rare qui peut entraîner la formation de tumeurs. Diagnostiquée après des années de symptômes non expliqués, elle a subi plusieurs opérations pour enlever des tumeurs sur ses glandes surrénales. Ania décrit les défis émotionnels et physiques de vivre avec VHL, y compris les difficultés de communication avec les médecins. Elle exprime sa gratitude envers le système de santé français et les professionnels de santé qui l’ont soutenue. Ania souligne l’importance de l’écoute et de la dignité dans les soins médicaux. Elle partage également l’impact de la maladie sur sa famille. Malgré les défis, Ania reste reconnaissante et trouve de la force dans son parcours.
Ania PAMULA
Ressenti et perception du risque par des patients atteints
de tumeurs rares induites par des expositions

AMAVEA est une association créée en 2018 après l’annonce de l’ANSM sur le lien entre les méningiomes et le médicament Androcur suite à l’étude EPI-PHARE. L’association vise à informer sur les risques des progestatifs et à soutenir les femmes touchées par les méningiomes. AMAVEA collabore avec l’ANSM et participe à la relecture des études. Elle compte environ 1000 adhérentes et dispose d’un conseil scientifique. L’association organise des visites de patients opérés du cerveau pour offrir un soutien moral. Un questionnaire a révélé que la majorité des patientes ont découvert leur méningiome après l’annonce de l’ANSM et que le neurochirurgien est souvent le premier à évoquer le lien avec les progestatifs.
Mireille HOURANI-BOUDEAU, Représentante pour l’association AMAVEA – diaporama
Lymphomes et Leucémies Lymphoïdes
Lymphomes EBV induits : rôle des prédispositions immunitaires

Le virus d’Epstein-Barr (EBV) est un virus qui infecte plus de 90% de la population mondiale avant l’âge de 25 ans. Il persiste à vie dans les lymphocytes B et peut causer des cancers, principalement des lymphomes. Les lymphomes associés à EBV sont souvent liés à des déficits immunitaires, soit acquis, soit génétiques. Les déficits immunitaires génétiques peuvent affecter la réponse des lymphocytes essentiels pour contrôler l’infection par EBV. Des mutations dans certains gènes augmentent la susceptibilité à EBV et le risque de lymphomes. Les recherches montrent que 15% des lymphomes pédiatriques peuvent être expliqués par des mutations germinales affectant le système immunitaire. La combinaison de prédispositions génétiques et d’expositions virales joue un rôle crucial dans le développement de ces lymphomes.
Sylvain LATOUR, CNRS, Institut Imagine – diaporama
Lymphomes dans le contexte du CMMRD
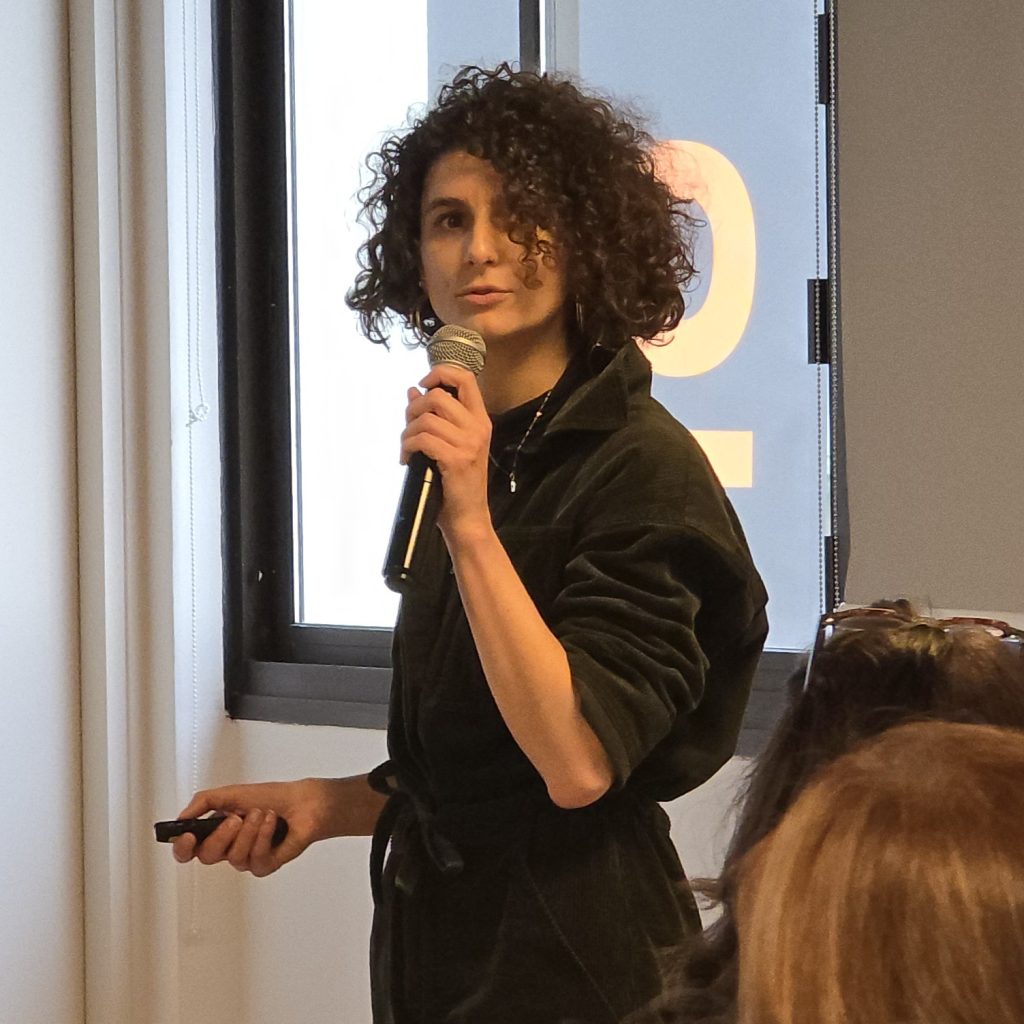
Le syndrome de déficience constitutionnelle de réparation des mésappariements (CMMRD) est une maladie rare qui prédispose les enfants à divers cancers, dont les lymphomes, en raison de mutations dans les gènes MMR. Les patients atteints de CMMRD présentent un risque élevé de développer des seconds cancers, avec un taux de 53% à 5 ans. La chimiothérapie standard reste efficace pour traiter les lymphomes, mais la survie à long terme est compromise par l’apparition de nouveaux cancers. L’immunothérapie, notamment les inhibiteurs de checkpoints immunitaires, pourrait offrir de nouvelles perspectives de traitement, mais des essais cliniques sont nécessaires pour évaluer leur efficacité et leur sécurité dans cette population.
Charlotte RIGAUD, Gustave Roussy – diaporama
Carcinome Hépatocellulaire et Hépatoblastome
Formes rares de carcinomes hépatocellulaires : rôle des infections virales
et de la génétique

Les carcinomes hépatocellulaires (CHC) sont fréquents, surtout sur foie cirrhotique, mais rares sur foie sain. Les CHC sur foie sain peuvent être causés par des infections virales comme l’hépatite B, qui entraîne des mutations insertionnelles dans le génome. D’autres facteurs environnementaux, comme l’aflatoxine B1 et l’acide aristologique, augmentent le risque de CHC. Les adénomes hépatocellulaires, souvent liés à la contraception orale, peuvent se transformer en CHC. Des mutations spécifiques, comme celles de BAP1, sont associées à des formes particulières de CHC sur foie non cirrhotique. Le carcinome fibrolamellaire, très rare et agressif, est caractérisé par une fusion génétique entre DNGB1 et PRKCA. Ces cancers rares nécessitent des recherches spécifiques pour des traitements adaptés, car les options actuelles sont limitées.
Jean-Charles NAULT, AP-HP H Avicenne, Centre de Recherche des Cordeliers – diaporama
Radiosensibilité et prédispositions génétiques
Etude des fibroblastes cutanés pour évaluer la radiosensibilité des tissus sains

La radiosensibilité humaine varie d’une personne à l’autre, influençant les réactions secondaires à la radiothérapie. Les fibroblastes de la peau sont souvent utilisés pour étudier cette sensibilité. La radiosensibilité est liée à la capacité des cellules à réparer les cassures double-brin de l’ADN. La protéine ATM est une protéine clé dans ce processus et se déplace du cytoplasme au noyau pour réparer les cassures après irradiation. Les personnes peuvent être classées en trois groupes : radiorésistants, hypersensibles (souvent dues à des mutations d’ATM), et un groupe intermédiaire avec des protéines X sur-exprimées qui piègent ATM, entraînant une mauvaise réparation de l’ADN. Cette classification aide à prédire les réactions aux radiations et à comprendre les risques de cancers radio-induits et de vieillissement accéléré. Les études montrent une relation entre la radiosensibilité des tissus sains et la tolérance des tumeurs aux radiations, influencée par des protéines spécifiques.
Nicolas FORAY, Inserm – diaporama
Signatures épigénétiques des gliomes radio-induits

Les gliomes radio-induits sont des tumeurs cérébrales rares qui apparaissent après une radiothérapie, souvent chez des enfants ayant survécu à un cancer pédiatrique. Le diagnostic de ces tumeurs a été révolutionné grâce à l’analyse du méthylome. Les études récentes ont identifié une signature épigénétique unique pour les gliomes radio-induits, distincte des autres types de gliomes. Ces tumeurs présentent souvent une activation aberrante de la voie des MAP kinases et des anomalies du cycle cellulaire. Les gliomes radio-induits partagent des caractéristiques avec les gliomes associés au syndrome CMMRD, suggérant une susceptibilité commune aux cassures double-brin de l’ADN. Ces découvertes permettent de mieux comprendre l’origine et le développement de ces tumeurs, ouvrant la voie à des diagnostics plus précis et à des traitements potentiellement plus ciblés.
Pascale VARLET, CH Sainte Anne – diaporama
Sarcomes radio-induits dans un contexte héréditaire

Les sarcomes en territoire irradié sont rares et hétérogènes, incluant les sarcomes des tissus mous et osseux. Ils sont souvent liés à l’exposition aux rayonnements ionisants et à des prédispositions génétiques. Définis par un antécédent de radiothérapie, une localisation dans le champ d’irradiation, et une histologie différente du cancer initial, ces sarcomes ont un pronostic sombre et sont souvent chimiorésistants. La protonthérapie est recommandée pour limiter l’irradiation des tissus sains. Les nouvelles immunothérapies pourraient offrir des alternatives prometteuses pour ces patients.
Camille TLEMSANI, AP-HP, Hôpital Cochin – diaporama





