Le jeudi 14 septembre 2023, le Cancéropôle IDF a organisé la première journée scientifique du groupe de travail Microenvironnement tumoral : construite autour d’un workshop et d’une session jeunes chercheurs, elle a permis aux professionnels franciliens travaillant sur les modèles 3D pour l’étude du micro-environnement tumoral d’échanger sur leurs pratiques.
Le matin, les participants ont pu échanger avec des experts franciliens des nouveaux modèles 3D lors d’un workshop: organoïdes, Tumor on Chip, Tumor slices. Une table ronde a permis de mettre en perspective les apports et limites de ces différents modèles pour l’étude du microenvironnement tumoral.
Louis Bastien Weiswald, co-responsable de la plateforme Orgapred du Centre François Baclesse, et Marc Van Wetering, ont ouvert l’après-midi avec deux keynotes lecture dans lesquelles ils ont partagé leurs perspectives sur l’utilisation des organoïdes pour la recherche sur les cancers.
Pour renforcer les liens au sein de la communauté francilienne travaillant sur le MET, les jeunes chercheurs sélectionnés lors d’un appel à communication ont présentés leurs travaux via des communications orales et des posters. Deux prix ont été remis à l’issue de la journée : le prix de la meilleure communication a été remis à Camille Compère, et le prix du meilleur poster à Flora Doffe.

INTRODUCTION

Cette introduction permet de présenter la journée de séminaire du groupe de travail sur l’étude du micro-environnement tumoral, coordonné par Éric Tartour et Sophie Siberil.
Le groupe se concentre sur les nouvelles technologies et les techniques émergentes dans ce domaine, ainsi que sur la promotion des échanges entre chercheurs et cliniciens. L’événement vise à partager des outils bioinformatiques, à développer un atlas du micro-environnement tumoral, et à organiser une journée scientifique annuelle sur des modèles émergents, avec un focus particulier cette année sur les modèles 3D.
Sophie SIBERIL, Sorbonne Université, Centre de Recherche des Cordeliers – diaporama
I. WORKSHOP : MODÈLES 3D
Le déchiffrage de l’hétérogénéité tumorale ainsi que des interactions complexes entre les cellules malignes et leur microenvironnement représentent un enjeu primordial pour améliorer le traitement du cancer. Créer et renforcer un réseau de chercheurs / ingénieurs franciliens développant différentes approches ou modèles a pour objectif de partager et rendre accessibles des « savoir-faire » et des outils
permettant l’étude du microenvironnement tumoral pour une utilisation nominale de modèles optimisés.
Modéliser les cancers, variations autour des organoïdes

Les modèles de cancer doivent rendre compte de la complexité et de l’hétérogénéité de la maladie, à l’échelle de la population, afin de générer des connaissances qui profiteront finalement aux patients. Le laboratoire de Fanny Jaulin établit une collection d’organoïdes dérivés de patients atteints de cancer. Il s’agit d’une approche réductionniste où l’idée est de se concentrer principalement sur les cellules cancéreuses et où sont ajoutés des composants contrôlés spécifiques pour construire la complexité du microenvironnement tumoral. Fanny aborde dans sa présentation le rôle des matrices extracellulaires dans la croissance et les propriétés invasives des cellules cancéreuses, ainsi que certains des travaux les plus récents de son équipe sur les cellules immunitaires.
Fanny JAULIN, Gustave Roussy – diaporama
Modèle Tumor on Chip : Advanced in tumor on chip development

Au cours des 15 dernières années, le domaine de la recherche en oncologie a connu des progrès significatifs dans le développement de nouveaux modèles de culture cellulaire, tels que les organoïdes ou les systèmes de tumeurs sur puce (Tumor on Chip, ToC). Les ToC offrent des avantages clés en permettant un contrôle précis de divers paramètres. Parmi ces paramètres figurent les propriétés de la matrice extracellulaire, les forces mécaniques exercées sur les cellules, l’environnement physico-chimique, la composition des cellules et l’architecture du microenvironnement tumoral. Un contrôle aussi fin permet aux ToC de reproduire fidèlement le microenvironnement complexe et les interactions au sein des tumeurs, ce qui facilite l’étude de la progression du cancer et des réponses thérapeutiques d’une manière hautement représentative. Il est important de noter qu’en incorporant des cellules dérivées de patients, les modèles ToC ont montré des résultats prometteurs en terme de validation clinique. Dans sa présentation, Stéphanie Descroix illustre le développement de ces Toc et les connaissances acquises à partir de l’utilisation de ce modèle à travers divers exemples.
Stéphanie DESCROIX, Institut Curie, IPGG, PSL – diaporama
Modèle Tumor-slices : Prévoir l‘efficacité et la toxicité des cellules CAR T à l‘aide d‘un modèle humain ex vivo

Le transfert adoptif de cellules T exprimant des récepteurs antigéniques chimériques (CAR) a montré une efficacité clinique remarquable contre plusieurs hémopathies malignes. Ce succès clinique a suscité un intérêt pour le développement de nouveaux CAR et l’extension de cette thérapie aux tumeurs solides qui sont, jusqu’à présent, réfractaires à cette stratégie.
Avant d’initier des essais cliniques, il convient de mettre en place des modèles dans lesquels les cellules CAR T peuvent être caractérisées et testées pour leur efficacité et leur sécurité. À ce jour, peu de modèles récapitulent parfaitement le système immunitaire humain et le microenvironnement tumoral. Par conséquent, la sélection d’un modèle pertinent est une étape cruciale dans l’évaluation du traitement par cellules CAR T et un enjeu majeur dans le domaine de l’immunothérapie du cancer. L’équipe d’Emmanuel Donnadieu est pleinement engagée dans le développement et l’optimisation d’un modèle ex vivo humain de tranches de tumeurs maintenues en survie. Elle utilise couramment des outils d’imagerie cellulaire pour étudier la distribution, la migration et l’activation des cellules CAR T et sont prévus la mise en œuvre de diverses techniques analytiques, y compris la transcriptomique spatiale, afin de mieux prédire les traitements d’immunothérapie.
Emmanuel DONNADIEU, Institut Cochin, CNRS, Inserm, Université Paris Cité – diaporama
Table ronde : Mise en perspective de l‘apport et des limites de chaque type de modèle

Les intervenants de la table ronde discutent des différents modèles scientifiques actuellement disponibles et soulignent l’importance de comprendre leur utilisation appropriée. Ils abordent également les attentes élevées des patients, notamment en matière de technologies pour la transplantation d’organes.
L’accès aux plateformes de recherche est souvent limité, nécessitant une collaboration étroite et des initiatives nationales et internationales pour faciliter le développement de modèles spécifiques.
Les modèles scientifiques sont complémentaires et doivent être choisis en fonction des besoins spécifiques de la recherche. Les modèles peuvent être utilisés pour tester des médicaments dans le cadre de la médecine personnalisée, offrant des possibilités de prédiction de la réponse des patients aux traitements. Les défis incluent la préservation des tissus, la prédiction des réponses aux traitements, et la complexité des systèmes. Ils évoquent la nécessité de bien comprendre le niveau de complexité requis pour reproduire fidèlement les conditions biologiques dans les modèles scientifiques.
La collaboration interdisciplinaire est essentielle pour surmonter ces défis. Ils soulignent l’importance de la formation et du partage des connaissances pour améliorer les pratiques de recherche.
Fanny JAULIN, Inserm, Gustave Roussy
Stéphanie DESCROIX, CNRS, Institut Curie
Emmanuel DONNADIEU, CNRS, Institut Cochin
Virginie DANGLES-MARIE, Institut Curie
Marion ESPELI, Inserm, Institut de Recherche Saint Louis
Isabelle CREMER, Sorbonne Université, Centre de Recherche des Cordeliers
Hélène MOREAU, Inserm, Institut Curie
KEYNOTE LECTURES
Modélisation du développement et de la maladie dans les organoïdes

L’épithélium intestinal est le tissu qui se renouvelle le plus rapidement chez les mammifères adultes. L’équipe de Marc van de Wetering a initialement défini Lgr5 comme un gène cible de Wnt, transcrit dans les cellules cancéreuses du côlon. Deux allèles knock-in ont révélé une expression exclusive de Lgr5 dans les cellules cylindriques de la base de la crypte. Grâce à des expériences de traçage des lignées chez des souris adultes, les chercheurs ont constaté que ces cellules cylindriques de la base de la crypte (CBC) Lgr5+ve généraient toutes les lignées épithéliales tout au long de la vie, ce qui implique qu’elles représentent la cellule souche de l’intestin grêle et du côlon. Il a ensuite été démontré que Lgr5 représentait un marqueur extrêmement spécifique et presque «générique» pour les cellules souches, notamment dans les follicules pileux, les reins, le foie, la glande mammaire, l’oreille interne, la langue et l’épithélium de l’estomac.
Les cellules souches Lgr5+ve triées individuellement peuvent donner naissance à des organoïdes crypto-villaires en constante expansion, appelés « mini-estomacs » en culture 3D. Cette technologie repose sur le fait que Lgr5 est le récepteur d’un puissant facteur de croissance des cellules souches, la R-spondine. Des systèmes de culture 3D similaires ont été développés pour les cellules souches Lgr5+ve de l’estomac, du foie, du pancréas et du rein. Les cultures d’organoïdes en 3 dimensions sont dérivées de tissus sains et tumoraux de patients atteints de cancer colorectal. Les organoïdes tumoraux reflètent fidèlement la tumeur en ce qui concerne le nombre de copies et le spectre des mutations et se prêtent à des criblages de médicaments à haut rendement, permettant de détecter les associations gène-médicament. La technologie des organoïdes pourrait ainsi permettre de concevoir des thérapies personnalisées.
Marc VAN DE WETERING, Princess Maxima Center for Pediatric Oncology, Utrecht, the Netherlands – diaporama
Apport des modèles de tumoroïdes à la recherche fondamentale et translationnelle en oncologie et applications à la médecine prédictive

Cette dernière décennie a vu l’apparition au sein des laboratoires des
cultures d’organoïdes tumoraux, ou tumoroïdes, dont l’émergence a permis d’enrichir le répertoire des modèles précliniques en oncologie. Ces structures multicellulaires tridimensionnelles, obtenues directement à partir d’échantillons tumoraux de patients, sont très proches de la tumeur dont elles dérivent. Les tumoroïdes offrent ainsi de nombreuses possibilités en termes de recherche fondamentale telles que l’étude de l’oncogenèse ou des mécanismes de résistance aux traitements. Leur utilisation s’avère également prometteuse dans les domaines de la recherche translationnelle (validation de nouvelles molécules à visée anticancéreuse, identification de nouvelles cibles thérapeutiques) ou de la médecine personnalisée via l’identification de signatures moléculaires prédictives et/ou la mise en place de tests fonctionnels prédictifs. Bien que l’optimisation des conditions de culture et la complexification du micro-environnement des tumoroïdes soient encore nécessaires pour améliorer leur pertinence et exploiter de façon optimale leur remarquable potentiel, de nombreuses applications sont déjà̀ envisageables dans le domaine de la prédiction de la réponse aux traitements et de l’orientation de la décision thérapeutique. L’introduction de leur utilisation en clinique pourrait ainsi bien faire entrer l’oncologie de précision dans une nouvelle ère dans le courant de la décennie à venir.
Louis-Bastien WEISWALD, Université de Caen Normandie, Inserm, CLCC François Baclesse – diaporama
Session jeunes chercheurs
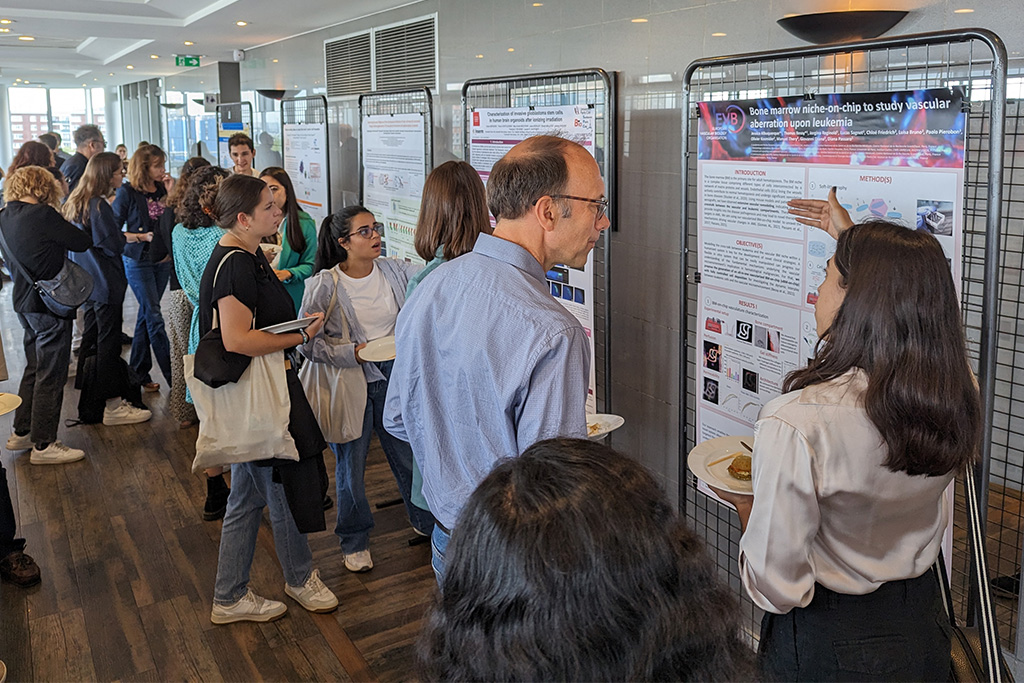

la meilleure communication 2023

L’un des objectifs de cette journée est de renforcer le réseau de chercheurs franciliens travaillant sur le micro-environnement tumoral. Pour mettre en avant le travail des jeunes chercheurs franciliens, un appel à communication a été organisé en amont de la journée. L’ensemble des abstracts présentés est disponible dans le livret de la journée.
Un jury composé des membres du groupe de travail MET du Cancéropôle IDF a attribué les prix suivants :
- prix de la meilleure communication orale : Camille COMPERE pour la présentation de son projet « Determining the specific features of the microvascular architecture of clear cell renal cell carcinoma by using a relevant in vitro 3D model of vascularized microtumors«
- prix du meilleur poster : Flora DOFFE pour la présentation de son projet « Development of 3D models to investigate functional tubologenesis, stromal environment and treatment sensibility in breast carcinoma.«





